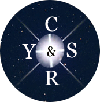 |
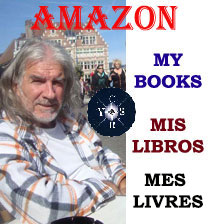 |
Amazon.com:LE CŒUR DE NOTRE-DAME MARIE DE NAZARETH:UNE HISTOIRE DIVINE |
LA PERSÉCUTION DE DIOCLÉTIEN ET LE TRIOMPHE DE L’ÉGLISE |
CHAPITRE PREMIER
LES CHRÉTIENS SOUS DIOCLÉTIEN ET MAXIMIEN HERCULE
(285-292).
I
Persécutions partielles à Rome et en Gaule.
Quand, après avoir défait en Mésie le dernier fils de
Carus, Dioclétien se trouva maître incontesté de l’Empire, des problèmes de
plus d’une sorte se posèrent devant l'ambitieux
Dalmate.
Le plus délicat et le plus grave regardait la conduite à
tenir vis-à-vis de l’Église chrétienne. Parmi les prédécesseurs du nouveau
souverain, les uns avaient tenté d’arrêter par la violence les progrès du
christianisme; d’autres avaient mieux aimé ne pas le voir, ou le confondre avec
les associations tolérées : un seul, Gallien, avait essayé d’une reconnaissance
légale, qui ne survécut pas à son auteur. Aujourd’hui, répandue sur tous les
rivages du monde romain, et jusque chez les Barbares, comptant ses adhérents
par millions, ralliant même, dans certaines parties de l’Orient, la majorité de
la population, l’Église attendait que l’État prit à son égard un parti décisif
et digne de tous deux. Fermer les yeux sur l’existence des chrétiens n’était
plus possible : ils s’étaient fait trop large leur place au soleil. Affecter
encore de ne voir dans l’Église que des associations de secours mutuels, des
«collèges de petites gens», paraissait désormais une fiction trop peu conforme
à la réalité. Accorder même à la religion chrétienne une tolérance précaire et
toujours révocable n’était qu’un expédient dilatoire, qui reculait la
difficulté sans la résoudre : le nombre croissant des fidèles obligerait tôt ou
tard le pouvoir civil à y renoncer. Que resterait-il, un jour ou l’autre,
probablement dans un avenir très prochain, sinon de travailler avec une suprême
énergie à l’anéantissement du culte chrétien, au risque d'être vaincu soi-même
dans cette dernière bataille; ou d'accepter au contraire de bonne grâce les
conquêtes du christianisme, de rendre définitive la solution éphémère tentée
par l'impuissant Gai lien, et de mettre fin pour jamais â des luttes qui
avaient grandi les victimes et déshonoré les bourreaux?
Deux fois, dans son long règne, Dioclétien examinera
cette alternative, et deux fois il décidera différemment.
En 285, au lendemain de son élection, il n’a encore
adopté aucune ligne de conduite, même provisoire. On vit probablement à Rome,
vers ce moment, quelques violences contre les chrétiens : cela parait résulter
d’un mot du liber Pontificalisqui montre le
pape Caius obligé de se cacher pour un temps dans les profondeurs du cimetière
de Calliste. Mais rien ne prouve que Dioclétien ait pris quelque part à ce
prolongement local de la persécution de Carinus.
Vint-il à
Rome après la mort de celui-ci? Le fait n'est pas invraisemblable, car des
bords du Margus, affluent du Danube, vers la frontière ouest de la Mésie, où
avait eu lieu la bataille dans laquelle Carinus fut
défait, il n’y avait que la Pannonie à traverser pour entrer en Italie :
c’était l’affaire de quelques jours de marche sur la voie militaire qui longeait
le Danube, ou mieux encore de quelques jours de navigation sur ce fleuve. Le
nouveau souverain peut avoir en hâte de paraître dans la ville où avait résidé
son prédécesseur, et qui était encore pleine du bruit des fêtes que celui-ci
avait données. Il était sûr d’être bien accueilli, sinon par le peuple, que Carinus avait amusé et flatté, du moins par les sénateurs
et tous les grands, cruellement maltraités sous le règne de ce tyran. Le sénat,
qui avait régi l’Empire après la mort d’Aurélien, qui avait élu Tacite et pensé
régner sous son nom, possédait encore, à la fin du troisième siècle, une
influence réelle: s’en servir eût été d’un habile politique. Dioclétien peut
avoir voulu faire hommage de son pouvoir à la haute assemblée, et lui en
demander la confirmation : démarche opportune de la part d’un prince qui,
appelé par ses goûts comme par ses intérêts à résider surtout en Orient, avait
besoin de trouver en Occident l’appui moral que seul, à cette époque, le sénat
pouvait lui offrir. L’hypothèse d’un séjour du nouvel empereur à Rome semble
donc naturelle, et comblerait même une lacune de l’histoire, qui ne nous
apprend rien sur ses actes entre le printemps de 285, époque de son avènement,
et l’hiver de la même année, où nous le trouvons définitivement établi en
Orient. Mais il faut bien avouer qu’aucun document certain ne nous renseigne à
ce sujet. En tout cas, si Dioclétien vint à Rome, on ne peut lui attribuer avec
assurance aucun acte personnel de persécution .
Que Dioclétien soit demeuré pendant les premiers mois de
son règne en Mésie et en Pannonie, ou qu'il en ait passé une partie en Italie,
il est certain que dans l’hiver de 285-286 il franchît le Bosphore, et se fixa
à Nicomédie. Des rivages de la mer de Marmara il pouvait surveiller à la fois
le Tigre, le bas Danube et l’Euxin, par où entraient
les envahisseurs de races diverses, attirés par les provinces d'Asie si riches
quoique si souvent pillées. Métropole de la Bithynie, cité assez opulente pour
avoir sous Trajan dépensé en travaux publics plus de trente millions de
sesterces, Nicomédie était aussi un ardent foyer dé paganisme: un des premiers
temples dédiés à Auguste vivant s’était élevé dans ses murs, et servait encore
de siège aux députés de la communauté d’Asie, de centre à leurs fêtes; elle
portait le titre de «deux fois néocore, ville sainte, lieu d’asile.» A la dévotion
officielle les habitants de Nicomédie joignaient une superstition opiniâtre :
jusqu’au troisième siècle ils avaient conservé sur leurs monnaies l’image du
dieu inventé par Alexandre d'Abonotique, le serpent Glycon; au siècle suivant l’exercice de la divination et de
la magie y sera encore florissant. Un tel milieu était favorable au fanatisme,
et contribuera peut-être à l’éclosion des idées persécutrices qui ensanglanteront
la fin du règne de Dioclétien. Mais, au moment où il s’établit à Nicomédie,
d’autres pensées occupaient son esprit.
Il y avait longtemps que les politiques sensés trouvaient
l’Empire trop vaste pour être gouverné par une seule tête, et surtout jugeaient
ses frontières trop nombreuses et trop menacées pour être défendues par une
seule épée. Dès le milieu du troisième siècle, Valérien avait senti qu'un
pouvoir unique devenait inégal à régir et à protéger ce grand corps : aussi,
près d'aller combattre et périr en Orient, avait-il laissé l’Occident à son
fils Gallien. La démonstration commencée alors s’était pour ainsi dire achevée
d’elle-même : après la chute de Valérien, on avait vu le monde romain se
diviser, afin d’opposer aux Barbares de l’est comme à ceux de l’ouest un front
toujours armé. L’énergique mais aveugle politique d’Aurélien avait arrêté ce
mouvement et rétabli par la violence une factice unité. Cependant Carus, en confiant
la Gaule à l’un de ses fils et en se portant avec l’autre en Orient, venait de
revenir d’instinct à la politique inaugurée par Valérien. La mort de Carinus avait remis maintenant l’autorité au seul Dioclétien
: allait-il la conserver sans partage, ou se décharger d’un fardeau trop lourd
en s’associant un collègue? Dioclétien eut la sagesse de prendre ce dernier
parti. Le 1er avril 286, il revêtit de la dignité d’Auguste le pannonien M.
Aurelius Valerius Maximianus.
Officier de fortune comme Dioclétien, et comme lui sans
naissance, sans éducation, sans lettres, Maximien avait de plus que lui
l'activité militaire, l'énergie du commandement: il n'oublia jamais sous la
pourpre l'amitié qui, dans les camps, l'avait uni à Dioclétien et la
reconnaissance due à l'homme qui avait fait sa fortune : toute sa carrière le
montre loyal et fidèle. Mais de grands vices jettent une ombre sur ces qualités
: Maximien, licencieux jusqu'à la débauche, avare et dissipateur tout ensemble, était naturellement cruel; il prenait
plaisir à verser le sang . Dioclétien fera faire quelquefois à ce rude soldat
de cruelles besognes, auxquelles, par calcul autant que par tempérament,
lui-même se jugeait impropre. Un tel choix n'était pas pour relever le pouvoir
souverain dans l'esprit des peuples; cependant, dès la nomination du nouvel
Auguste, Dioclétien laissa deviner la transformation que sa politique fera
subir par degrés à la dignité impériale. Sept ans auparavant, Probus recevait,
dit-on, les ambassadeurs du roi de Perse assis à terre dans son camp et
mangeant comme un soldat un morceau de lard salé ; mais cette simplicité
républicaine ne suffisait plus à Dioclétien. Dans sa pensée, le pouvoir de
l'empereur romain est trop fragile et trop menacé pour que celui-ci puisse impunément
se contenter d’être le premier des magistrats et le premier des généraux. Il
faut qu’un rayon du ciel tombe désormais sur le souverain et le rende
inviolable en le transfigurant aux yeux des peuples; sa robe de pourpre devra
devenir «le manteau de l’immortel Zeus.» Aussi, bien que personnellement peu
dévot aux vieilles divinités de Rome, Dioclétien, lorsqu’il éleva Maxîmien à l’empire, prit-il pour lui-même le nom de
Jupiter et donna-t-il à son collègue celui d’Hercule, que nous lui conserverons
dans la suite du récit.
De graves nouvelles arrivées de Gaule avaient peut-être
hâté le choix de Dioclétien. Dans ce pays venait d’éclater une révolte de
paysans, excitée à la fois par les usurpations des riches et les exactions du
fisc. Déjà, quelques années auparavant, un rhéteur gallo-romain avait traduit
en phrases d’une extrême énergie les colères qui grondaient dans le cœur des
prolétaires ruraux. D’un côté, l’extension demeurée des grandes propriétés
submergeait en beaucoup de lieux, comme une marée montante, les petits champs
voisins; de l'autre, le fisc, levant l’impôt à l’aide du fouet et de la
torture, achevait la misère des paysans. Ceux-ci cherchaient un refuge dans les
opulents domaines qui s’étaient formés des débris de la petite propriété :
colons, ils se mêlaient aux esclaves et aux serfs, et, attachés comme eux à la
glèbe, finissaient par perdre les derniers privilèges de l’homme libre.
Accablés de prestations et de corvées, payant pour eux-mêmes, payant souvent
pour le propriétaire du sol, ces malheureux finirent par ne plus prendre
conseil que de leur désespoir. «On nous pousse aux armes; désormais, nous
n’aurons plus d’autre loi que notre colère : et, quelles que soient les forces
de nos adversaires, nous sommes aussi forts qu’eux, si nous ne tenons pas à la
vie. » Ainsi se formèrent sur divers points de la Gaule ces troupes de
désespérés, auxquels on donna le nom celtique de Bagat ou Bagad, multitude. De tous les domaines, tenanciers, esclaves, venaient à eux
: une armée prête pour la révolution sociale s’organisait. On comprendra quel
pouvait être le nombre de ces soldats d’un nouveau genre, quand on se
souviendra qu'un seul noble gaulois, au milieu du troisième siècle, avait pu
lever sur ses terres deux mille hommes armés. Les agriculteurs, dit un
panégyriste, prirent promptement les habitudes militaires. Le laboureur se fit
fantassin; les pâtres, accoutumés à garder à cheval leurs troupeaux, et déjà à
demi brigands, formèrent une cavalerie redoutable. Un sourd réveil de
nationalité gauloise, suscité par les druides, qui erraient encore dans les
montagnes et les forêts, et gardaient leur influence sur le paysan
superstitieux, se mêla peut-être à ce mouvement de désespoir.
Pour conduire et discipliner une telle armée, il fallait
des chefs: deux hommes se rencontrèrent, qui se mirent à sa tête, et prirent
même le titre d’Augustes. Ces empereurs des esclaves et des paysans s'appelaient Ælianus et Amandus. On a
prétendu qu'ils étaient chrétiens : une Vie de saint, écrite au septième siècle
, dit même que ceux qui leur obéissaient s'étaient soulevés en haine du
paganisme, et refusaient de se soumettre aux adorateurs des dieux. Il semble
qu’au temps où cette légende fut rédigée, une tradition, dont il est impossible
de découvrir l’origine, représentait l'insurrection des Bagaudes comme une
révolte chrétienne. Rien, cependant, n’est moins fondé qu’une telle opinion. M.
Duruy dit fort justement : «Les chefs de brigands sont souvent populaires : la
guerre qu'ils font aux riches semble aux pauvres des représailles légitimes.
Les Bagaudes restèrent dans la mémoire du peuple comme les défenseurs des
malheureux.» De là à en faire des chrétiens la distance n'était pas grande :
l’imagination naïve du septième siècle la franchit sans peine. Qu'il y ait eu,
mêlés aux paysans insurgés, quelques chrétiens, cela ne paraît pas impossible :
tous n'étaient pas des saints, quelques-uns étaient poursuivis par des créanciers
ou par le fisc, et plusieurs de ces malheureux purent chercher un refuge dans
le camp des rebelles, comme on avait vu, sous Valérien, des chrétiens faire
cause commune avec les Barbares qui ravageaient la province du Pont. Mais on ne
saurait étendre au corps entier ce qui fut la faute d’un petit nombre
d’individus seulement. Les chrétiens pris en masse n’ont jamais transgressé le
devoir d’obéissance aux lois enseigné par l’Évangile et imposé par l’Église. A
cette observation générale j’ajouterai deux arguments, qui me paraissent
décisifs. En 286, époque de la guerre des Bagaudes, les fidèles des Gaules
n’étaient molestés nulle part: depuis 275, date de la mort d’Aurélien, ils
jouissaient d’une paix complète. Comment auraient-ils choisi un tel moment pour
se révolter, eux qui restèrent patients et soumis au milieu des plus dures
épreuves des persécutions? De plus, la révolte des Bagaudes fut essentiellement
une révolte de pâtres et de paysans. Mamertin, Eutrope, Orose, Eusèbe, saint
Jérôme, le disent en termes formels. Or le christianisme, très répandu dans les
villes à la fin du troisième siècle, était à peu près inconnu dans les
campagnes gauloises, que saint Martin, au siècle suivant, trouvera encore
toutes païennes, attachées même avec un fanatisme sauvage au culte de leurs
dieux. Une insurrection dont tous les éléments furent pris dans la population
rurale ne peut avoir eu pour mobile la haine du paganisme et la défense de la
religion chrétienne. Si quelque symbole religieux parut sur ses drapeaux, ce
fut celui des vieilles divinités celtiques.
Chargé par Dioclétien de dompter cette redoutable
révolte, Hercule se hâta de quitter Nicomédie : par les provinces danubiennes,
il gagna le nord de l’Italie, et de là Rome.
Un des premiers soins d’Hercule fut la formation d'un
corps expéditionnaire, capable de lutter contre la multitude insurgée. La Gaule
proprement dite ne renfermait presque pas de troupes : une cohorte légionnaire
à Narbonne, une à Bordeaux, une en Belgique; une cohorte de la garde urbaine de
Rome détachée à Lyon; une cohorte de Liguriens dans la petite province équestre
des Alpes Maritimes : en tout trois mille soldats environ pour maintenir la
paix dans une région qui correspond à la France, à la Suisse, à la Belgique, à
une partie de la Hollande, de la Prusse et de la Bavière Rhénanes. Cette absence
de forces militaires dans l’intérieur du pays explique la facilité avec laquelle
se propagea l’insurrection. Sans doute dix légions étaient massées à la
frontière, dans les camps permanents des deux Germanies;
mais la présence des Barbares, si redoutables à cette époque, ne permettait
sans doute pas d’en diminuer le nombre. On comprend ainsi comment Hercule dut,
avant d’entrer en Gaule, composer une armée de légions ou de détachements
empruntés à des contrées moins menacées. Le rendez-vous de ces divers corps
parait avoir été l’Italie. Si l’on en croit des pièces hagiographiques, c’est à
Rome qu’ils furent reçus et concentrés. Aussi peut-on attribuer au séjour
d’Hercule dans la capitale de l’Empire une recrudescence de la persécution
locale dont cette ville avait précédemment souffert: peut-être périrent alors,
en juillet, Zoé, Tranquillin et quelques autres
fidèles, dont les Actes de saint Sébastien racontent le martyre.
Quand toutes ses troupes eurent été rassemblées, Hercule
se mit en route, au mois de septembre. Il se dirigea vers la Gaule par le nord
de l’Italie, et, suivant une route très fréquentée au troisième et au quatrième
siècle, franchit les Alpes au Summus Pœninus (Grand-Saint-Bernard). Son plan était de pénétrer
le plus rapidement possible dans le bassin de la Seine, afin d’étouffer la
rébellion, qui semble avoir eu son foyer principal aux environs de Lutèce.
Cependant, après la pénible traversée des Alpes Pennines, Hercule sentit le
besoin de se reposer et de laisser respirer son armée. Il s’arrêta dans la
principale ville du Valais, sur les bords du Rhône, à moitié route entre le Summus Pœninus et le lac Léman.
Les troupes, qui avaient pris les devants, reçurent l’ordre de suspendre leur
marche. Un des corps qui les composaient campa en un lieu appelé Agaune, à quatorze milles de l’extrémité orientale du lac
Léman. «Ce lieu est situé dans une vallée, entre les chaînes des Alpes. On y
arrive par une route escarpée, car le Rhône, dans son cours impétueux, laisse à
peine au pied des rochers un passage pour les voyageurs. Mais quand, malgré
tous les obstacles, on a franchi les gorges étroites de ces défilés, aussitôt
l’on voit s’ouvrir une plaine assez étendue entre les montagnes.» Cette plaine
fut témoin d’une scène terrible, dont le souvenir a été conservé par une tradition
que l’on peut suivre, d’anneau en anneau, jusqu'à une époque rapprochée des
faits.
Bien que le document qui la raconte lui soit postérieur
de plus d'un siècle et doive un grand nombre de détails à l'imagination du
narrateur, je n'hésite pas à l’accepter dans l'ensemble.
Voici comment les choses me paraissent s’être passées.
Parmi les troupes campées dans la vallée d’Agaune se trouvait un détachement auquel la postérité a conservé
le nom de «légion,» mais qui semble avoir été soit une simple vexillatio empruntée à la légion d'Égypte, soit une
cohorte auxiliaire, composée de cavaliers et de fantassins, choisie parmi
celles qui gardaient l'extrême frontière méridionale de la Thébaide,
vers les districts de Syène, d'Éléphantis et de Philæ. Ces soldats transportés si loin de leur pays
d’origine étaient tous chrétiens, ce qui n’étonnera pas si l’on veut bien se
souvenir que le christianisme était alors très florissant en Égypte, même parmi
les troupes qui y tenaient garnison. Placés tout à coup entre leur religion et
leur devoir militaire, les Thébéens commirent une
faute grave contre la discipline, car, pour obéir à leur conscience, ils
désobéirent aux ordres de l’empereur.
Hercule venait d’ordonner à toute l’armée de se
concentrer à Octodure, pour prendre part, avec lui, à
un sacrifice solennel destiné à appeler la faveur des dieux sur l'expédition
périlleuse qu’on allait entreprendre. Dans les grands dangers publics, d’extraordinaires
démonstrations religieuses furent quelquefois accomplies. C’est ainsi que, en
de nombreuses circonstances, le sénat fit faire des supplications pour la
patrie menacée. Vingt-six ans avant les événements que nous racontons, quand
les Marcomans eurent envahi l’Italie, Aurélien contraignit les sénateurs à
ouvrir, malgré leur répugnance, les livres sibyllins: un amburbium solennel eut lieu, et l’on offrit même, semble-t-il, des sacrifices humains.
Parfois c’est aux armées, en face de l’ennemi, que l’on recourait à des moyens
inusités de conjurer la colère des dieux. Dans la guerre des Quades, Marc
Aurèle, après avoir consulté le serpent Glycon,
présida lui-même à des sacrifices offerts devant les légions, sur les bords du
Danube: deux lions vivants furent jetés dans le fleuve. Telles étaient les
superstitions dont, en de rares circonstances, les soldats furent rendus
témoins et complices. On croira sans peine que le grossier Maximien, né dans la
Pannonie, où florissait le culte des divinités étrangères, ne se soit pas
montré plus philosophe que Marc Aurèle, et ait voulu contraindre tous les corps
de troupes enrôlés sous ses drapeaux à se souiller par des cérémonies idolâtriques.
Il peut aussi avoir obligé les soldats à se lier par un serment spécial avant
d’entrer en campagne contre les Bagaudes. Les légions avaient plus d’une fois,
en Gaule, fait cause commune avec les rebelles; c’est elles qui, naguère,
établirent et soutinrent pendant quatorze années l’empire de Posthume et de ses
successeurs: Hercule pouvait craindre qu’elles n’eussent aujourd’hui encore
pour le peuple insurgé de secrètes sympathies. En soi, l’engagement demandé
n’aurait eu rien de contraire à la conscience chrétienne. Mais ce serment,
distinct du sacramentum prêté par tous les soldats lors de leur incorporation
dans l’armée, devait sans doute être mêlé d’invocations idolâtriques et
d’imprécations sacrilèges. C’est ainsi que Scipion, après la bataille de
Cannes, contraignit les jeunes gens dont il craignait la désertion à prononcer
après lui ces terribles paroles: «Je jure que je n’abandonnerai jamais la
République, ni ne souffrirai qu’aucun citoyen l’abandonne. Si je manque à cet
engagement, que Jupiter, très bon et très grand, inflige à ma maison, à ma
famille et à moi la plus cruelle mort.» Un chrétien n'eût pu répéter sans
apostasie des imprécations de ce genre.
Aussi les Thébéens refusèrent-ils d’accomplir les ordres d’Hercule, et non seulement de participer
au sacrifice, mais même de prêter le serment. Au lieu de se mettre en marche
vers Octodure, ils demeurèrent à Agaune.
Dès que l’empereur connut leur désobéissance, il fut saisi d’une violente
colère. Probablement il vit dans le refus des Thébéens autre chose qu’une résolution inspirée par la conscience: de bonne foi il put
se figurer d’abord que ceux-ci faisaient alliance avec les rebelles. La
docilité avec laquelle ils se soumirent au châtiment dut le détromper bientôt,
sans toucher son âme farouche. Recourant tout de suite à la plus terrible des
peines inscrites dans le code militaire, Hercule commanda de décimer les Thébéens. On sait comment cette peine s’exécutait. En
présence du reste de l’armée comparaissaient les soldats coupables de désobéissance
ou de désertion. On tirait au sort, et chaque dixième, après avoir été battu de
verges, était décapité devant ses camarades. Mais l'exécution accomplie, les
survivants ne se montrèrent pas plus traitables. Mis de nouveau en demeure de
suivre l’injonction sacrilège du tyran, les Thébéens protestèrent de leur attachement au Christ et de leur résolution de ne rien
faire contre sa loi. Hercule les fit décimer une seconde fois.
Trois officiers soutenaient par leurs exhortations le
courage de ces soldats chrétiens: c’étaient Maurice, Exupère et Candide. Sommés
une dernière fois de se soumettre, les Thébéens,
dociles aux conseils de ces généreux chefs, refusèrent unanimement de trahir
leur Dieu. On leur fait tenir un admirable langage, qui traduit bien, sinon
leurs paroles exactes, du moins les sentiments dont ils étaient animés. «Nous
avons vu égorger les compagnons de nos labeurs et de nos périls; nous avons été
couverts de leur sang. Cependant nous n'avons point pleuré la mort de ces très
saints camarades; nous les avons estimés heureux de souffrir pour Dieu. Et
maintenant, même l’extrême danger ne fait pas de nous des rebelles : le
désespoir ne nous arme pas contre toi, ô empereur! Nos mains tiennent des
armes, et nous ne résistons pas; nous aimons mieux mourir que tuer, mourir
innocents que vivre coupables. Tout ce que tu ordonneras contre nous, le feu,
les tourments, le glaive, nous sommes prêts à le souffrir.» Les Thébéens devinaient le sort qui les attendait. La violence
d’Hercule était connue: on le savait cruel par goût autant que par politique;
et Dioclétien lui-même le comparait à Aurélien, dont la dureté pour les soldats
restait célèbre. Maximien n’ordonna pas de décimer une troisième fois les héros
chrétiens; il commanda de massacrer la troupe entière. «On vit ces soldats
frappés A coups d’épée, sans se défendre; déposant leurs armes, jetant casque,
bouclier, cuirasse, pour offrir leur gorge et leur poitrine au glaive des exécuteurs.
Ni le nombre ni les armes ne leur inspirèrent la pensée de venger par le fer la
justice de leur cause : ils se souvinrent seulement qu’ils représentaient Celui
qui se laissa mener à la mort sans protester, l’agneau divin qui n’ouvrît pas
la bouche pour se plaindre. Brebis du Seigneur, ils se laissèrent déchirer par
les loups. La plaine fut bientôt couverte des cadavres des saints, et leur sang
ruissela sur le sol»
On dit que quelques-uns, ayant pu s’échapper, furent
rejoints et immolés en diverses villes; mais deux seulement sont connus avec
certitude, Ursus et Victor, tués à Soleure. Un
émouvant épisode marqua, dans la plaine d’Agaune, la
fin du massacre. Les exécuteurs venaient de se partager les dépouilles de leurs
camarades égorgés. Ces dépouilles (pannicularia),
abandonnées aux bourreaux par d’anciennes lois contre lesquelles la
jurisprudence essaya vaine ment de réagir, consistaient, aux termes d’un rescrit
d’Hadrien, dans les objets trouvés sur les corps des condamnés : vêtements,
bourses, anneaux, etc. On se rappelle les soldats jouant aux dés, sur le Calvaire,
la robe sans couture du Sauveur. Hadrien refuse aux exécuteurs le droit de
s’approprier les objets les plus précieux laissés par les victimes, pierres fines,
obligations de sommes d’argent. Mais, dans ces tueries en masse, de telles
règles étaient probablement oubliées, et les soldats avaient ou prenaient la
permission de faire main basse sur toute espèce de dépouilles. Il ne fallait
pas moins, peut-être, pour leur donner le courage d’accomplir une horrible
besogne. Après le massacre des Thébéens, les exécuteurs,
joyeux du butin qu’ils avaient recueilli, s’assirent par groupes et
commencèrent un bruyant repas. A ce moment, un vétéran, nommé Victor, retiré du
service militaire, fut amené par les hasards d’un voyage au lieu où s’était
passée la scène sanglante, remplacée maintenant par l’orgie. Les soldats
l’engagèrent à manger avec eux; mais il se retira plein d’horreur. Ivres de
sang et de colère, les meurtriers le poursuivirent, lui demandant s’il était
chrétien. «Je le suis, et le serai toujours, » répondit le vétéran. Aussitôt l’on
se jeta sur lui : et le cadavre d'un nouveau martyr tomba près de ceux qui couvraient
déjà la plaine ensanglantée.
Après ces cruelles exécutions, Hercule entra en Gaule, où
il ne trouva pas les difficultés auxquelles il s'était attendu. Poussant devant
lui les bandes insurgées, les battant en détail, il atteignit enfin le camp où
le gros de leur armée s'était retranché, dans la presqu’île formée par la
Marne, à une lieue de Lutèce. Ce ramassis de laboureurs et de pâtres ne put
tenir devant des troupes régulières: Hercule en eut promptement raison.
Cependant, malgré l'assertion des historiens, «la Bagaudie»
ne fut pas exterminée: ses adhérents se répandirent en fugitifs dans le pays,
gagnant les bois, les retraites inaccessibles; pendant de longues années le
brigandage ne cessa pas en Gaule, où l'on retrouve des Bagaudes jusqu'au
cinquième siècle. Aussi la poursuite des vaincus, la recherche des suspects,
durent-elles suivre la victoire, et, dirigées par un tyran comme Hercule,
amener de sanglantes représailles. On dit que les chrétiens ne furent pas
épargnés. Furieux de la désobéissance des Thébéens,
considérant dès lors tous leurs coreligionnaires comme des rebelles, Hercule
parait avoir marqué par de nombreux martyres son séjour en Gaule.
Des Actes de rédaction tardive et souvent gâtée par la
légende, mais dont l’accord et le rapprochement méritent cependant l’attention,
montrent l’empereur et ses lieutenants versant en plusieurs villes le sang des
fidèles. De nouveaux édits n’étaient pas nécessaires : celui d’Aurélien n’avait
pas été abrogé; pour le faire revivre il suffisait d’une dénonciation particulière,
d’un incident local: les circonstances politiques s’y prêtaient facilement.
Aussi voyons-nous le magistrat chargé, apparemment comme légat de la Lyonnaise,
des vengeances de son maître dans le pays des Parîsii,
n’épargner pas plus les chrétiens que les insurgés : martyre, à Lutèce, de
l’évêque Denys et ses compagnons Rustique et Éleuthère; martyre de saint
Nicaise et de plusieurs autres, sur les confins des Parisii et des Véliocasses; à l’autre extrémité de la
province, dans la ville de Nantes, mort des deux frères Rogatien et Donatien,
l’un déjà chrétien, l’autre baptisé par son martyre.
D’autres documents hagiographiques nous montrent le légat
de la Belgique parcourant pendant au moins deux années les principales villes
de cette vaste province, et, au cours de ses tournées officielles, condamnant
des chrétiens: à Amiens, Fuscien et Victoric; à
Augusta Vermanduorum, l’évêque dont elle prendra le
nom, Quentin; A Soissons, Crépin et Crépinien; dans la même ville, Rufin et
Valère; à Reims, de nombreux martyrs anonymes; à Fismes, près de Reims, Macra; peut-être Lucien, à Beauvais; probablement Piaton, à Tournai. On pourrait admettre qu'à la Belgique le
même magistrat joignit le gouvernement de tout l’est de la Gaule, c’est-à-dire
les deux Germanies inférieure et supérieure, car les
mêmes documents disent qu’il fit mourir des fidèles à Trêves et à Bâle. Le
légat d’Aquitaine parait avoir aussi marché dans cette voie sanglante: Agen vit
le martyre de sainte Foi et de saint Caprais.
Les seuls martyrs de la Grande-Bretagne dont le souvenir
ait été conservé appartiennent vraisemblablement aussi à cette époque. Une tradition
attribue à l’année 286 la mort de saint Alban, qui, ayant recueilli un prêtre
fugitif et favorisé son évasion, comparut pour ce fait devant les juges, se
confessa chrétien, et fut décapité. Ce martyre parait avoir eu lieu à Verulam. Un grand nombre d'autres chrétiens, parmi lesquels
Aaron et Jules, furent aussi massacrés à Caerleon; d'autres, dit-on, à Lichfield.
On raconte qu'après ces exécutions la persécution cessa tout à coup. Cette fin
des rigueurs exercées contre les fidèles peut coïncider avec la fin de la
domination de Maximien Hercule dans le pays, renversée vers les derniers mois
de 287 par l’usurpation de Carausius, puis d’Alectus,
qui tinrent successivement la Bretagne avec le titre d’Auguste, jusqu’à ce quelle eût été, en 296, reconquise par Constance.
Maximien demeura dans les Gaules pendant six années,
occupé à préparer une expédition contre son ancien lieutenant Carausius, et
surtout à repousser les Alemans, les Burgondes et les Francs. Il eut pour
résidence habituelle Trêves, l’ancienne capitale de Posthume: c’est là qu’au
1er janvier 288, prenant possession de son second consulat, on le vit tout à
coup en dépouiller les ornements, sauter à cheval et repousser une attaque des
Barbares; c’est là que deux fois le rhéteur Mamertin prononça son panégyrique;
c’est autour de Trêves qu’il établit des colons Lètes et Francs. Mais il semble
qu’avant de se fixer dans cette Rome du Nord, dans cette « ville auguste, »
comme on l’appellera bientôt, Hercule ait visité la région méridionale de la
Gaule, l’ancienne «province» romaine. Un document chrétien qui, sans être
contemporain, n'est cependant pas d'une époque assez éloignée des faits pour
avoir perdu toute valeur historique, le montre à Marseille, au mois de juillet,
encore animé contre les fidèles par le souvenir de la légion Thébéenne : le séjour en Narbonnaise se place probablement
en 287, et précède l’établissement définitif d’Hercule dans la Belgique.
Bien que déchue de son ancienne splendeur, Marseille
occupait dans la Gaule un rang à part. Elle en était le grand port d'exportation,
entassant sur ses quais et dans ses bassins, à destination d’Ostie, les produits
industriels et agricoles de tout le pays. Mais cette ville commerçante était
aussi une ville lettrée: ses écoles rivalisèrent avec celles d’Athènes. Même au
troisième siècle, elle demeurait pour la patrie gauloise le centre de
l’hellénisme, comme Naples pour l’Italie. Les dieux qu’elle adorait étaient la
Diane d’Éphèse et l’Apollon de Delphes : le temple de celui-ci, rendez-vous des
Ioniens, l’Ephesium de celle-là, dominaient toute la
cité du sommet de l’acropole. La constitution de Marseille restait toute
grecque: république autonome, elle se gouvernait elle-même; une aristocratie de
six cents membres, à la tête de laquelle étaient le conseil des quinze et les
trois timouques, présidait à ses destinées. Dans ses rues, sur ses quais, le
grec était parlé autant que le latin et le gaulois. Malgré la corruption des
mœurs, une décence extérieure réglait les plaisirs publics : les jeux impurs
des mimes furent longtemps interdits sur les théâtres de Marseille. La sérénité
grecque, ennemie des démonstrations bruyantes, y modérait jusqu'aux deuils: les
funérailles se célébraient sans lamentations, et un repas funèbre les terminait.
On raconte que, dans cette ville fréquentée cependant par des matelots de
toutes les nations, les crimes étaient si rares, que le glaive destiné au
châtiment des coupables s'était rouillé. Bien que plusieurs traits de ce tableau
ne conviennent probablement plus â la fin du troisième siècle, Marseille devait
offrir encore une physionomie originale quand Maximien Hercule la visita.
L'auteur de la Passion de saint Victor loue son étendue, la force de ses
remparts, «sa glorieuse beauté,» son activité commerciale, le nombre et la
richesse des habitants. «C’était pour les contrées d’Occident, dit-il, le siège
principal de la puissance romaine.»
Comme tous les grands ports de l’antiquité, Marseille
était aussi une ville dévote. Les voyageurs venus de tous les pays, et
particulièrement des contrées orientales, y avaient apporté leurs religions;
près des dieux grecs florissait le culte des divinités étrangères. Le christianisme,
répandu dès les premiers temps sur les côtes de la Méditerranée, et qui avait
pénétré au second siècle dans tout le bassin du Rhône, compta aussi de bonne
heure des adhérents à Marseille. Elle parait avoir eu des martyrs dès l’époque
des Antonins, peut-être au moment où périssaient à Lyon les victimes de la
persécution de Marc Aurèle. Lors de l'arrivée d'Hercule, la population
chrétienne devait être nombreuse. La présence d'un tyran couvert encore du sang
des Thébéens la frappa de terreur. Un officier
chrétien, nommé Victor, qui faisait probablement partie des troupes dont
l'empereur était accompagné, s'efforça de ranimer le courage des fidèles.
Dénoncé ou surpris, il fut traduit devant le tribunal des préfets de sa légion:
se montrer ouvertement chrétien, si près encore des événements d’Agaune, était pour un militaire de cette armée un crime
capital. Cependant les préfets s'efforcèrent de persuader Victor : lui parlant
avec douceur, ils l'exhortèrent à ne pas préférer aux dieux, à son service
militaire, à l'amitié de l'empereur, le culte d'un homme mort. Mais Victor,
d'une voix forte: «Ceux que vous appelez des dieux, s'écria-t-il, sont d'impurs
démons. Je suis le soldat du Christ: le service militaire, l'amitié de
l'empereur ne me sont plus rien, si je ne les puis conserver qu'en méprisant
mon vrai roi.» Parmi les cris des assistants, Victor proclama la divinité de
Jésus-Christ, ressuscité des morts. A cause de son grade, les préfets le
renvoyèrent à l'empereur.
Celui-ci, voulant faire un exemple, commanda de lier
Victor et de le traîner à travers les rues de la ville. En d'autres lieux, le
peuple, devenu indifférent ou même sympathique aux chrétiens, avait cessé de
manifester contre eux de la haine: mais dans cette ville pleine de fanatiques,
les vieilles passions duraient encore : ce fut au milieu des coups et des
outrages que le martyr subit cette première épreuve. Sa résolution n'en fut pas
ébranlée: ramené devant les préfets, il confessa le Christ. Les magistrats se
disputèrent, dit-on, au sujet des tortures à lui infliger: l'un d'eux, Eutychius, se retira; Asterius,
demeuré seul, livra le soldat chrétien aux coups des licteurs. L’auteur des
Actes raconte qu'à ce moment Jésus apparut au patient pour l'encourager. Dans
la prison, où il reçut de nouveau la visite céleste, Victor convertit trois
soldats, Alexandre, Longin et Félicien, qui reçurent aussitôt le baptême. Par
l'ordre du «grand dragon Maximien,» il fut conduit avec les néophytes au forum;
le peuple y courut en foule. On commanda à Victor de ramener au culte des dieux
ceux qu'il en avait détournés : «L'édifice que j’ai bâti, je ne le détruirai
pas,» répondit-il. Les trois soldats persistèrent dans leur nouvelle foi, et
furent décapités. Victor, après avoir subi le chevalet, fut encore une fois mis
en prison. Après trois jours, il comparut de nouveau devant Hercule. Celui-ci
voulut le contraindre à sacrifier. Un prêtre s’approcha, tenant dans la main un
autel. «Offre de l’encens, apaise Jupiter, et sois notre ami,» dit l’empereur.
Mais, saisi d'une soudaine indignation, Victor arrache l’autel des mains du
prêtre, le jette à terre et pose sur lui le pied. Hercule commanda de couper ce
pied sacrilège, puis, inventant un supplice horrible, fit conduire Victor aux pistrines publiques, où son corps, « froment choisi de
Dieu,» fut à demi broyé sous la meule. Comme il respirait encore, on lui
trancha la tête. Les restes des martyrs, jetés à la mer, furent recueillis par
les chrétiens, qui creusèrent dans un rocher une crypte pour les recevoir .
Ces cruautés, exercées par Maximien Hercule en personne
ou par des gouverneurs dociles à son impulsion, cessèrent probablement quand il
se fut fixé à Trêves, tournant tous ses regards vers l’Angleterre, où régnait
Carausius, et le Rhin, que franchissaient sans cesse les Germains. Aussi
peut-on supposer que, deux ans après qu’il eut passé les Alpes, la condition
des chrétiens s’améliora dans la Gaule, comme elle s’était apparemment
améliorée déjà en Italie, et que les Églises purent de nouveau jouir dans
l’Occident de cette paix relative qui était leur partage en dehors des
persécutions déclarées.
II Les Églises, le néo-paganisme et la philosophie.
Depuis la courte persécution d’Aurélien, l’Orient, plus
heureux, n’avait point vu la paix troublée. C’est à peine si deux ou trois
épisodes locaux, que nous avons racontés en leur temps, en avaient fait sentir
la fragilité. Celle-ci même avait bientôt cessé d’être aperçue: presque
partout, on s’était accoutumé à regarder comme définitif le repos dont on
jouissait. Les deux sociétés, païenne et chrétienne, vivaient l’une auprès de
l’autre, sans se mêler beaucoup, mais sans se heurter.
Le christianisme, encore nouveau dans quelques parties de
l’Occident, ne l’était plus dans aucune des provinces de la presqu’île
asiatique. En Syrie, en Galatie, en Bithynie, en Phrygie, dans l’Asie proconsulaire,
il datait de l'aurore même de la prédication évangélique. Ses dogmes, ses
cérémonies, ses mœurs, n’étaient là pour personne une chose inconnue. Les
païens n'avaient même plus sous les yeux le spectacle irritant de conversions
en masse opérées par la parole enthousiaste et persuasive de quelque
missionnaire. Ces contrées évangélisées de longue date avaient cessé d'être,
comme nous dirions aujourd'hui, des «pays de mission» :l’Église y avait la vie
forte et traditionnelle d’une institution plusieurs fois séculaire. D’innombrables
familles lui appartenaient depuis maintes générations: le mouvement qui faisait
entrer dans son sein de nouveaux prosélytes s’opérait maintenant d’une façon
régulière, insensible, comme une marée qui monte, non comme une inondation qui
se précipite. Le mot de Tertullien : Fiunt,
non nascuntur christiani, avait
depuis longtemps cessé d’être vrai en Orient: la population chrétienne s'y
recrutait d'elle-même, par sa fécondité propre; plus elle devenait nombreuse,
plus elle attirait, en vertu d’une loi naturelle, les âmes hésitantes,
partagées entre les charmes de la nouvelle foi et la peur de l’inconnu. Comme
on avait de moins en moins à craindre de se singulariser en devenant chrétien,
on cédait plus facilement aux touches délicates de la grâce ou au généreux
entrainement de l’exemple.
Il n'était pour ainsi dire pas de ville dans l’Empire romain,
où les fidèles ne formassent une minorité compacte, disciplinée, puissante par
le nombre comme par l'autorité morale: en quelques cités même, la majorité
paraissait leur appartenir déjà. Mais, tandis qu'en Occident c'étaient surtout
les populations urbaines qui avaient des fidèles, le christianisme était, en
Asie, aussi répandu dans les campagnes que dans les villes. Sans doute, la
proportion numérique des sectateurs des deux cultes variait suivant les lieux:
même en plein quatrième siècle, le paganisme sera dominant en certaines parties
de l’Asie, alors qu'en d'autres il aura presque disparu : à plus forte raison,
ces différences locales étaient sensibles sous Dioclétien. Cependant, si l'on
se contente d'une appréciation générale, où il entre nécessairement une grande part
d'inconnu, on ne se trompera peut-être pas en estimant que, dans les provinces
asiatiques de l’Empire, le nombre des fidèles, à cette époque, balançait
presque celui des sectateurs du paganisme. Les historiens évaluent à, cent
millions la population totale de l'Empire: l’Asie romaine, alors très peuplée,
en comprenait probablement le tiers : on se rend compte de l’importance de la
population chrétienne dans ces régions, plus vite conquises que toutes les
autres à l’Évangile.
Loin de mettre obstacle à la paix religieuse, la venue de
Dioclétien en Asie contribua plutôt à la consolider et à l’étendre. Les
sentiments défavorables aux chrétiens, que combattaient peut-être déjà des
influences domestiques, cédèrent promptement à l’action bienfaisante d’un
milieu nouveau. Le séjour de la superstitieuse Nicomédie ne suffit pas à
entretenir ou à réveiller en lui le fanatisme. Des contacts plus intimes et
plus doux achevèrent d’incliner son âme à la tolérance. Il ne parait pas douteux
que sa femme Prisca et sa fille Valeria aient été soit chrétiennes complètes,
soit au moins catéchumènes. Bien que nul document n’indique l’époque de leur
conversion, on peut la reporter avec vraisemblance au temps de l’établissement
définitif de Dioclétien en Orient. Peut-être est-elle due à quelqu’un de ces
serviteurs chrétiens que l’histoire nous montre aussi nombreux pour le moins
dans le palais impérial de Nicomédie que dans celui de Rome. Eusèbe rapporte
que Dioclétien les aima comme ses propres enfants. «Que dirai-je, ajoute- t-il,
de ceux de nos coreligionnaires qui servaient dans le palais? A eux, à leurs
femmes, à leurs enfants, à leurs esclaves, on laissait la faculté de suivre
ouvertement leur religion : libres de se glorifier de leur foi, ils étaient
préférés par le souverain à tous ses autres serviteurs. Parmi eux fut Dorothée,
qui montra tant de bienveillance à nos frères, et pour cette cause mérita
d'être élevé en dignité au-dessus de tous les magistrats et de tous les
gouverneurs de provinces. On doit lui joindre le célèbre Gorgonius,
et tant d'autres qui, dociles à la parole de Dieu, partagèrent leur gloire.» Un
de ceux-ci, Pierre, est nommé ailleurs par l’historien: il était, comme les
précédents, au nombre des intimes serviteurs du prince, eunuques ou
cubiculaires, qui, dans une cour déjà façonnée à l'étiquette orientale,
approchaient seuls «la divine personne» du maître, et obtenaient quelquefois, à
ce titre, un pouvoir ou des honneurs supérieurs à ceux des plus hauts magistrats.
La faveur de Dioclétien ne s'arrêtait pas aux chrétiens
du palais impérial : elle s’étendait à ceux des fidèles qui voulaient servir
l’État dans les charges publiques. Les fidèles s’en abstenaient ordinairement,
parce qu’à l’exercice des magistratures étaient presque toujours attachées des
obligations contraires à leur conscience : offrir des sacrifices, donner des
jeux, par conséquent renier le Christ soit dans sa religion, soit dans sa
morale. Mais toutes les fois que des empereurs tolérants avaient permis à ceux
que leur naissance appelait aux honneurs de s’abstenir de ces accessoires de
leur charge, et d’en remplir seulement les devoirs essentiels, on les avait vus
accepter avec joie l’occasion de se rendre utiles au public. Quelques exagérés,
souvent plus voisins des sectes hérétiques que de l’Église orthodoxe,
persistaient seuls dans une abstention systématique: la grande masse des
chrétiens, docile à l’enseignement modéré de ses chefs, ne les suivait pas dans
cette voie fausse. Aussi les vrais fidèles s’empressèrent-ils de mettre à
profit les bienveillantes dispositions de Dioclétien. Celui-ci nomma au
gouvernement de plusieurs provinces des chrétiens déclarés, en les dispensant
des sacrifices, comme s’en dispensaient déjà, sous ses yeux mêmes, sa femme et
sa fille. Eusèbe nous fait connaître deux de ces fonctionnaires, qui furent
plus tard martyrs: «Philorome, investi dans
Alexandrie d’une charge élevée de l'administration impériale, et qui, à cause
de sa dignité et de son rang parmi les Romains, rendait chaque jour la justice
entouré de soldats; Adauctus, Italien de naissance,
ayant passé par toutes les charges de la cour, et obtenu celle d’intendant des
finances et du domaine impérial, qu’il exerçait avec la réputation d’une grande
intégrité .»
L’aristocratie chrétienne des villes put aussi remplir,
sans faire acte d’idolâtrie, des charges municipales, là du moins où ne
dominait pas une intolérante majorité de païens. D’un concile tenu apparemment
avant la dernière persécution, pendant la période de paix qui nous occupe, nous
apprenons que, même en Occident, des fidèles eurent la dignité de flamines municipaux
sans sacrifier et sans donner des jeux. Cependant ces fonctions, exercées sous
le regard des habitants d’une même ville, jaloux de leurs coutumes et de leurs
pompes locales, pouvaient entraîner quelque concession apparente aux usages
idolâtriques : il était difficile aux flammes de ne pas porter au moins la
couronne des prêtres, insigne de leurs fonctions, aux duumvirs de ne pas
veiller à l’entretien des temples et des théâtres: l’Église les toléra
néanmoins, en leur imposant de légères pénitences. Mais dans certaines cités,
surtout en Orient, cette indulgence ne fut pas nécessaire. Soit que la masse de
la population y professât déjà le christianisme, soit que le gouverneur de la
province fût lui-même chrétien, ou au moins très tolérant, on vit les charges
municipales de plusieurs villes gérées par des fidèles, sans aucun compromis
entre leurs fonctions et leur foi. Une ville de Phrygie avait tous ses
magistrats chrétiens, le logiste, le stratège, les membres de la curie. En
Thrace, un des décurions d’Héraclée put même être diacre sans cesser de siéger
dans rassemblée municipale et d’entretenir des rapports amicaux avec les
bureaux du gouverneur. Un prêtre chrétien d’Antioche fut nommé directeur des
teintureries impériales de Tyr.
Telle était, dit Eusèbe, «la grande bienveillance que les
souverains montraient alors à notre religion.» Cette bienveillance fut
naturellement imitée par les officiers publics, surtout dans les régions où résidait
l'empereur. Eusèbe, témoin oculaire, note «les égards, le respect, les grands
honneurs accordés à l'évêque de chaque Église par tous les magistrats et les
gouverneurs.» Depuis longtemps déjà les évêques avaient été, par la force des
choses, tirés de l'obscurité et de la retraite, pour prendre rang parmi les
personnages principaux des cités. On se souvient de Gallien reconnaissant leur
dignité et leur adressant nominativement des rescrits. On n’a pas «oublié la
grande place occupée par Paul de Samosate dans une cité aussi considérable qu’Antioche.
En Espagne, des évêques comme saint Fructueux avaient gagné naguère l'affection
des païens. Maintenant, les hommages officiels consacraient la situation acquise,
et les gentils eux-mêmes s'accoutumaient à regarder avec respect des hommes
auxquels les magistrats rendaient honneur.
Les évêques se hâtèrent de mettre à profit ce moment
favorable. Se croyant sûrs de l'avenir temporel de leurs communautés, voyant
leurs ressources acrues, leurs entreprises
protégées, ils voulurent donner au culte chrétien la splendeur qui lui manquait
encore. Une soudaine émulation s'empara d’eux, comparant aux beaux temples du
paganisme les humbles édifices, cachés souvent dans les faubourgs, dont
s'étaient jusqu'à ce jour contentés les chrétiens. Il fallait d'ailleurs
préparer des abris plus spacieux à leur multitude, chaque jour croissante à la
faveur de la paix, et que les anciennes églises ne suffisaient plus à contenir.
Aussi vit-on non seulement celles- ci embellies et agrandies, mais de nombreux
et vastes édifices chrétiens, «neufs depuis les fondations,» s’élever «dans
toutes les villes» et prendre place parmi leurs monuments. A Nicomédie,
l’église principale, fort haute, fut construite sur une colline, en vue du
palais impérial. Une des églises de Carthage, la basilica novorum, dont nous parlerons plus tard en
racontant la persécution, fut probablement aussi bâtie à cette époque. Au même
temps remonte le canon du concile d’Illiberis prohibant dans les églises les peintures « e tout ce qui est honoré et adoré» ;
discipline rigoureuse et tout exceptionnelle, qui s’explique apparemment par
des circonstances locales, mais fait supposer qu’en Espagne comme ailleurs on
renouvelait alors et on décorait les édifices sacrés. Il semble qu’on ressentit
une fièvre de construction religieuse égale à celle qui agita certaines années
du moyen Age, et que l’on ait pu dire dès lors, comme fera sept siècles plus
tard un chroniqueur, que «le monde se revêtait de la blanche robe des églises.
»
Ce mouvement se fit sentir à Rome comme dans le reste de
l’Empire. Il n’est pas douteux que, parmi les églises titulaires qu’on y
comptait au cinquième siècle, beaucoup n’aient été fondées avant la dernière
persécution. Probablement les plus anciennes furent agrandies ou même
reconstruites pendant la paix dont jouirent les fidèles après les orages qui, à
Rome, les avaient agités au début du règne de Dioclétien. Cependant, en cette
capitale où le paganisme étalait ses pompes officielles, où ses grands sacerdoces
avaient leur siège, où l’aristocratie lui restait presque entière attachée par
intérêt et par politique autant que par conviction, le chef de l’Église, malgré
sa suprématie reconnue de la puissance publique elle-même , ne pouvait
entretenir avec les sénateurs et les consuls des rapports analogues à ceux qui
s'étaient noués entre les autres évêques et les fonctionnaires des villes de
province. Aussi l'expansion extérieure et pour ainsi dire monumentale du
christianisme parait-elle s'être faite à Rome avec moins d'assurance
qu'ailleurs. Au lieu qu'en Orient Eusèbe montre les nouveaux sanctuaires
chrétiens s'élevant au centre même des villes, à Rome presque toutes les
églises titulaires occupent une zone relativement excentrique. La partie
centrale, le cœur de la ville, où se trouvaient le Capitole, le Palatin, la
Voie Sacrée, les divers Forums, le Grand Cirque, ne renferme pas dans ses
quatre régions de « titres » chrétiens dont on puisse placer l'origine avant la
fin des persécutions. Les pontifes qui gouvernèrent successivement l'Église de
Rome au temps qui nous occupe, Caius et Marcellin, conservaient la mémoire de
la persécution partielle qui venait d'y sévir, et croyaient peu à la durée du
repos dont celle-ci avait été suivie.
Aussi semblent-ils avoir porté surtout leur attention sur
les catacombes, où l’un d’eux avait, dit-on, cherché naguère un refuge. Ils
profitent de la sécurité momentanément rendue aux chrétiens pour y faire de
grands travaux. La nature même de ces travaux montre que ceux qui les
ordonnèrent sentaient l’instabilité de la situation présente, et craignaient
une persécution future. Avant la dernière moitié du troisième siècle, les
assemblées liturgiques qui avaient lieu à certains jours dans les cimetières
s’étaient surtout tenues dans les salles ou petites basiliques élevées à la
surface du sol, entre les limites de l’enclos extérieur. Après les édits
seulement qui, violant le droit commun des sépultures, interdirent sous Valérien
la fréquentation des cimetières chrétiens, les fidèles s’accoutumèrent à tenir
secrètement des réunions dans leurs parties souterraines. L’architecture
intérieure des catacombes commença à se transformer à partir de cette époque:
les chambres funéraires s’agrandirent, prirent la forme de salles de réunion ou
même de petites basiliques, afin de rendre possible la célébration des saints
mystères devant un grand nombre d’assistants. Les dernières années du troisième
siècle furent employées à multiplier dans les catacombes ces chapelles
souterraines : les papes semblent avoir songé dès lors au jour où non seulement les sanctuaires extérieurs des
cimetières seraient de nouveau interdits, mais où même les églises de la ville
ne pourraient plus être fréquentées. De là, dans la partie du cimetière de
Calliste qui paraît avoir été aménagée vers cette époque par une branche
chrétienne de la gens Aurélia, l’excavation de vastes salles, recevant l'air et
le jour par des luminaires, communiquant souvent entre elles par groupes de
deux, trois ou même quatre, et pouvant contenir de nombreux fidèles: Tune, creusée
par les soins de l'archidiacre Severus, porte la date du pontificat de
Marcellin. Au cimetière Ostrien, sur la voie Nomentane, plusieurs cryptes, garnies d'une sorte de tribune
où devaient être posés l'autel avec le siège du pontife, appartiennent à cette
époque: une inscription donne la date de 291. La prévision des papes parait
avoir été plus loin encore : redoutant que les cimetières possédés en commun
par l'Église romaine fussent, dans un jour prochain, l'objet d'une
confiscation, ils paraissent avoir obtenu des possesseurs de l'antique hypogée
connu sous le nom de Priscille, sur la voie Salaria, et demeuré propriété
privée, l’autorisation de creuser des galeries et des chambres à l’étage
inférieur: ce travail, dont on admire les vastes proportions et la régularité
extraordinaire, fut commencé en vue de préparer un nouvel asile aux sépultures
des fidèles.
On voit qu’à Rome l’autorité ecclésiastique ne s’endormait
pas, et se tenait prête à tout événement. Ailleurs, il n’en était pas de même:
une sécurité exagérée avait pénétré les âmes, et, comme il arriva plusieurs
fois dans les premiers siècles, amolli les courages. Une messe latine contient
une prière qui porte en elle sa date, et appartient à ces époques incertaines
où le christianisme naissant flottait, pour ainsi dire, entre la paix et la
persécution; avant la récitation des diptyques renfermant les noms des
martyrs, des confesseurs, des fidèles défunts, le prêtre demande à Dieu, «si le
repos sourit, de continuer à le servir, si la tentation survient, de ne pas le
renier». Beaucoup d’Églises avaient oublié l’un et l’autre péril : se croyant
assurées contre le retour de la tempête, elles s’abandonnaient aux douceurs de
la paix, sans songer qu’il y a plusieurs manières de renier Dieu, et que dans
la paix comme dans la tempête on lui peut devenir infidèle. Plusieurs canons du
concile d'Illiberis montrent les abus qui, même en
Occident, s'introduisaient dans les mœurs et la discipline. On y voit non
seulement les vices que la morale chrétienne eut à réprimer dans tous les
temps, mais encore les désordres particuliers aux époques de prospérité. Les
mariages entre chrétiens et infidèles, les divorces, la cruauté envers les
esclaves, la possession d'esclaves de luxe et de plaisir, l'usure, la délation ,
la diffamation publique, la négligence des offices chrétiens, la fréquentation des
cérémonies païennes, les jeux de hasard, les sortilèges, sont reprochés au
peuple et frappés de peines canoniques; de plus, nous apprenons du concile que
des vierges consacrées à Dieu oubliaient leurs engagements, que des évêques, des
prêtres et des diacres menaient une vie scandaleuse, ou abandonnaient leurs églises
pour fréquenter les marchés et faire le négoce, que des clercs prêtaient à
intérêt. Sans doute, de ce que des fautes sont énumérées et punies parles
canons, il serait téméraire de conclure qu'elles étaient communes à tous, et
autre chose que des exceptions; cependant le soin avec lequel elles sont ici
notées montre que ces exceptions se produisaient quelquefois, et que les
évêques réunis à Illiberis de tous les points de
l'Espagne sentaient la nécessité de guérir des maux qui menaçaient de s'étendre
à leurs Églises, grâce au relâchement universel produit par la paix.
Nous n'avons point pour l’Orient de documents aussi précis
: mais plusieurs phrases d'Eusèbe, malheureusement trop oratoires, nous font
connaître la situation des chrétiens dans ces contrées où leur sécurité paraissait
encore plus grande. Même en taxant de quelque exagération les paroles d’un
contemporain plus frappé, comme il arrive souvent, du mal que du bien, plus
empressé à condamner les fautes de ceux qui manquaient à leurs devoirs qu’à
rappeler les vertus de tant d’autres qui demeuraient fidèles, on doit avouer
que beaucoup d’Églises d’Orient étaient en décadence. «La liberté dont elles
jouissaient avait fait tomber leurs membres dans la négligence et la mollesse.
De là étaient sorties les rivalités, les guerres intestines, où les paroles
blessent comme des armes. On avait vu les évêques s’élever contre les évêques,
les peuples contre les peuples... Sourds aux avertissements de la justice
divine, les chrétiens semblaient croire avec les impies que les choses humaines
vont au hasard, sans providence qui les conduise; aussi multipliaient-ils tous
les jours leurs crimes : les pasteurs, méprisant les règles de la religion, se
déchiraient mutuellement : chacun voulait le pouvoir, pour en faire une
tyrannie.» Eusèbe laisse dans l’ombre les désordres moraux, soit que les
Églises d’Orient en eussent été heureusement préservées. soit que les divisions
qui y régnaient et surtout les rivalités des chefs lui parussent le trait
principal du triste tableau offert par ces Églises aux regards des chrétiens et
des païens.
Les païens intelligents observaient avec soin ces
défaillances, et s'efforçaient d'en profiter pour attirer les chrétiens
douteux. On connaît révolution insensiblement accomplie par le polythéisme, et
parvenue à son apogée dans la seconde moitié du troisième siècle. Ses forces
dispersées jadis se sont concentrées en une sorte de monothéisme solaire,
donnant satisfaction tout ensemble à la raison qui
tend chaque jour davantage vers l’unité divine, et aux habitudes idolâtriques,
qui veulent un Dieu matériel. Les autres divinités ne sont plus que des émanations,
des vertus ou des symboles du dieu Soleil, adoré seul sous tant de noms
différents. C’est lui qui parait dans Apollon aux flèches lumineuses, dans
Mithra, feu purificateur, dans Sérapis ou dans Baal. Jupiter, bien qu'assimilé
parfois aux divinités solaires, demeure cependant le dieu politique,
personnification de la souveraineté : quand Dioclétien veut entourer son pouvoir
d'une auréole sacrée, il choisit le nom de Jovius, pour faire entendre qu'il
est la tête pensante de l’Empire, dont son collègue Hercule sera le bras. Mais
s'il est appelé à se justifier devant l'armée du meurtre d'un de ses
prédécesseurs, c'est un dieu «plus certain», le Soleil, qu'il prend à témoin (et,
plus tard, avant de se décider à proscrire les chrétiens, il ira consulter un
oracle d’Apollon. Même pendant les années de paix qui précédèrent cette
résolution suprême, les chrétiens furent plus d'une fois sollicités d'adhérer à
leur tour au culte nouveau, qui absorbait et résumait tous les autres. Déjà, de
telles avances avaient été repoussées par l'inébranlable foi de l’Église; mais
le moment paraissait favorable pour les renouveler. A en croire les polémistes
païens, la transition était ménagée d’avance par renseignement chrétien
lui-même. Jésus n’est-il pas appelé la lumière du monde? le soleil de justice?
Dieu n’a-t-il pas, selon les Écritures, placé son tabernacle dans le soleil? Un
hérésiarque de la fin du second siècle, Hermogène, avait appliqué ce texte au
Christ, et prétendu que le corps ressuscité du Sauveur habitait le soleil:
peut-être en souvenir de cette traduction grossière d’une poétique métaphore,
dès le temps de Tertullien on imputait aux chrétiens d’adorer l’astre radieux.
Que leur restait-il à faire, sinon de prendre à la lettre les paroles des
prophètes, des évangélistes et du Sauveur lui-même, et, sans abjurer le dogme
de l’unité divine, sans renoncer même aux formes particulières de leur culte,
d’entrer dans le concert que formaient maintenant toutes les religions
antiques? Cet appel venait bien en son temps, alors que beaucoup d’Églises
étaient envahies par l’esprit du monde, tandis que la religion païenne
s’expliquait dans un sens chaque jour plus spiritualiste et plus raisonnable.
Ses défenseurs, ou plutôt ses réformateurs, s’appliquaient à écarter d’elle
tout reproche d’idolâtrie. A les en croire, les statues des dieux n’eurent
jamais d’autre objet que de perpétuer leur souvenir et de les rendre présents à
la pensée des adorateurs; même les mythes les plus obscènes et les plus
révoltantes pratiques prenaient une haute signification religieuse ou morale;
les sacrifices étaient simplement le symbole de l’amour et de la reconnaissance
des hommes envers l’Être suprême dont ils ont reçu tous les biens. «Les
chrétiens, disaient ces avocats du paganisme, imitent nos temples, puisqu'ils
construisent de grands édifices pour leurs assemblées religieuses, quoiqu’ils
puissent prier Dieu dans leurs maisons, car Dieu sans doute écoute partout les
prières». Entre le culte païen, dont au prix de bien des contradictions on
épurait ainsi la théorie, et le culte chrétien qui rivalisait maintenant de
splendeur avec lui, n'y avait-il donc pas de conciliation possible? Des églises
comme des temples, l'encens et les prières ne pourraient-ils pas s’élever vers
un même Être suprême, le Dieu visible, la lumière dont les rayons éclairent
tout homme qui vient en ce monde?
Ces raisonnements reposaient sur une équivoque: rien,
dans le fond, ne se ressemblait moins que le Dieu du syncrétisme païen, informe
conciliation de tous les systèmes, depuis les grossières religions de la nature
jusqu'au spiritualisme le plus raffiné, et le Dieu unique, vivant, personnel,
distinct du monde qu’il a créé, le Dieu jaloux de la Bible et de l’Évangile.
Mais quelques ignorants, mal défendus par des mœurs relâchées et une discipline
affaiblie, purent se laisser prendre à de séduisants sophismes : on dit même
que des esprits d'une trempe plus ferme passèrent, vers ce temps, de l’Église
au paganisme. Tels sont Théotecne et, si l’on en
croit certains témoignages, Hiéroclès, qui figureront
parmi les fauteurs les plus intelligents et les plus cruels de la persécution
de Dioclétien.
Tous deux adoptèrent les doctrines néoplatoniciennes, qui
depuis Porphyre se posaient de plus en plus en rivales du christianisme. Il est
difficile de saisir dans son essence cette mobile philosophie: elle se modifie
selon ses interprètes, paraissant avec Porphyre une libre pensée presque aussi
éloignée du néo-paganisme que de la religion
chrétienne, redevenant païenne avec Jamblique par la théurgie et la divination,
plus tard s’attachant avec Julien â la dévotion officielle et au culte solaire.
Mais tous les Alexandrins de la fin du troisième siècle et du commencement du
quatrième ont un sentiment commun, la haine du christianisme. Porphyre, si près
quelquefois de l’Évangile par la pureté de sa morale et la sublimité de ses aspirations
religieuses, est acharné à en poursuivre les sectateurs. Entre 290 et 300, il
composa un ouvrage en quinze livres contre les chrétiens. On ne saurait, avec
quelque vraisemblance, faire de lui aussi un transfuge du christianisme, comme
l’ont essayé quelques écrivains: mais peut-être des circonstances domestiques
autant qu'une rivalité de philosophe le tournèrent-elles contre l’Église. Un
passage de la lettre à sa femme Marcella insinue que les concitoyens de
celle-ci essayaient de la détacher des doctrines de son mari, comme pour
l’attirer à l’Évangile. Quoi qu’il en soit, les livres de Porphyre contre les
chrétiens, dont beaucoup de passages ont été conservés par les écrivains du
quatrième siècle, montrent qu'il avait étudié avec le plus grand soin l’Ancien
et le Nouveau Testament. Comme Celse, il annonce une partie des objections que
l'irréligion moderne croit avoir inventées. Mais par plus d’un trait il diffère
de Celse. Celui-ci, tout à la raillerie et à l’invective, est le Voltaire du
paganisme : Porphyre en serait plutôt le Renan. Il reconnaît la beauté morale,
la sainteté de Jésus, et cite des oracles qui le proclamaient un grand homme de
bien, un sage, un immortel. Mais c'est pour taxer de folie les disciples qui
adorent comme un Dieu leur maître né d'une femme et mort sur une croix. Sa
critique paraît d’hier: il affirme que les prophéties de Daniel ont été écrites
après coup, puisque l'événement les montre accomplies. Très habilement surtout
il bat en brèche le système d'interprétation allégorique des livres saints,
appliqué avec excès par Origène, et, après avoir ramené tout à la lettre, il
soumet celle-ci à un minutieux examen. Le Nouveau Testament est particulièrement
passé au crible. Comme fera Strauss, il s'efforce d'y montrer des
contradictions, des inexactitudes, des invraisemblances. S'élevant parfois à
des vues plus hardies, il devance l'école de Tubingue en mettant en lumière le prétendu antagonisme de saint Pierre et de saint Paul.
Par le souvenir de la fortune qu’ont eue de nos jours cette recherche des antinomies
ou ces hautaines affirmations, accompagnées parfois d’hommages attendris à la
personne de Jésus séparé de ses disciples et de son œuvre, on se rendra compte
de l'effet que les quinze livres de Porphyre durent produire sur l'opinion des
contemporains. Pour le dissiper, les vrais fondateurs de l’exégèse chrétienne
n'auront pas trop de tout un siècle.
Porphyre ne demeura pas sans imitateurs. Dès leur
apparition, ses livres firent école: toute une littérature antichrétienne s'en
inspira. Porphyre, du moins, avait écrit avant la persécution, et jamais
n'appela contre ses adversaires les rigueurs de la puissance publique. D'autres
seront moins généreux : nous assisterons au répugnant spectacle d'écrivains
officiels insultant par la plume les chrétiens au moment de les poursuivre
comme magistrats. Mais avant de raconter l'effort suprême de l'Empire contre
l’Église, et la part qu'y prirent les sophistes, il nous reste à exposer les
réformes politiques et administratives de Dioclétien, qui auront une grande
influence sur les vicissitudes locales de la prochaine persécution.
L'ÉTABLISSEMENT DE LA TÉTRARCHIE ET LA PERSÉCUTION DANS L’ARMÉE
(292-302).
|
 |
 |
 |
 |